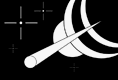|
|
|
| |
Les cratères d’impacts terrestres occurrents depuis le début de l’ère archéenne ont quant à eux subi un sort assez semblable sur une Terre géologiquement active, et soumise, entre autres, aux érosions atmosphériques et océaniques. Il reste toutefois traces d’environs 200 d’entre eux (ainsi qu’une centaine en attente d’homologation) plus ou moins visibles, le plus vieux étant celui de Suavjärvi en Russie avec ses 2.4 milliards d’années, un des plus gros celui de Sudbury au Canada avec ces 140km de diamètre, et le plus connu le fameux « Meteor Crater » en Arizona avec ses 50 000 ans et 2.3km de diamètre. En France aussi nous avons notre structure d’impact, celle de Rochechouart près de Limoges, vieille de 214 millions d’années et large de 5km (liée à d’autres cratères datant de la même époque, comme celui de Manicouagan). Dans tous les cas, quelque soit l’état de conservation de la formation, la géologie du lieu est toujours assez intéressante, parfois même économiquement comme dans le cas de Sudbury, plus gros gisement mondial de nickel. Ce métal plutôt rare dans la croûte terrestre était vraisemblablement contenu à la base dans la météorite de 10km de diamètre qui heurta le futur Canada il y a 1.87 milliard d’années.
|
|
|
|
|